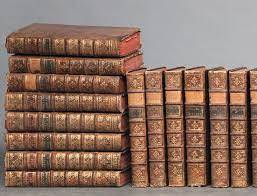IBAÏOMA :
(ref nec) Ancienne appellation "ibaïona". Jambon de cochon né, élevé et abattu en pays basque. Depuis 1985, trois éleveurs et charcutiers se sont entendus pour créer un cahier des charges exigeant de produire un jambon perpétuant la vieille tradition de la charcuterie basque. Nourris à base de céréales sans OGM et sans antibiotiques, les porcs sont abattus lorsque leur poids excède 180 kg, vers l’âge de 11 mois minimum. Affiné à l’air libre, le jambon met de 15 à 20 mois pour développer sa robe claire et un gras persillé et moelleux.
I.G.P (Indication Géographique Protégée)
(economie.gouv.fr) L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. L’IGP repose par ailleurs sur la notion de savoir-faire. Elle consacre une production existante et lui confère dès lors une protection à l’échelle nationale mais aussi internationale. En France, cela concerne par exemple le jambon de Bayonne, le canard à foie gras du Sud-Ouest, etc. L’IGP est liée à un savoir-faire. Elle ne se crée pas, elle consacre une production existante et lui confère dès lors une protection à l’échelle nationale mais aussi internationale. Pour prétendre à l’obtention de ce signe officiel lié à la qualité et à l’origine, une étape au moins parmi la production, la transformation ou l’élaboration de ce produit doit avoir lieu dans cette aire géographique délimitée.
ILE FLOTTANTE :
(La Varenne) "Faites bouillir du lait avec un peu de farine ; mettez-y ensuite six blancs d’oeufs ; remuez bien, sucrez et lorsque vous serez prêt de servir, remettez sur le feu, et glacez ; ou bien jetez par dessus le reste de vos blancs bien frits ; passez y légèrement un couvert de four, et servez sucré avec quelques eaux de senteur. Vous pouvez, au lieu de blancs, y mettre le jaune de vos œufs à proportion, et les blancs frits par dessus. La crème à la Mazarine se fait de même, hormis que vous n’y mettez point de blancs d’oeufs"
(H. This, Les îles flottantes ne sont pas des oeufs à la neige) :
En quoi les « œufs à la neige » diffèrent-ils des « îles flottantes » ? Après tout, on voit les mêmes images, sur des sites internet grand public ou professionnel… qui ne donnent aucune référence, aucun justification. Or, dans ce genre de cas, quand on voit deux noms pour le même objet, c’est généralement qu’il y a des confusions !
Menons donc une enquête sérieuse, en commençant par un livre de pâtisserie professionnelle réputé : celui de Pierre Lacam, publié en 1934. Là, on trouve des oeufs à la neige, qui se font à partir de blancs battus et sucrés bien fermes, qu’on met sur du lait vanillé que l’on fait bouillir ; puis, avec le lait, on fait une crème anglaise et l’on nappe les œufs. Lacam signale également que l’on peut pocher dans un moule que l’on met lui-même au bain marie pendant 1/4 d’heure ou au four pendant dix minutes, même sauce dessus. Et il termine par des « Œufs neige à la reine » : « Rangez des œufs à la neige en couronne autour d’un moule à cylindre jusqu’en haut, et remplissez le vide avec une crème anglaise, collée à la vanille; démouler sur plat d’argent et arroser avec une crème vanille bien lisse ».
Mais pas d’île flottante, dans ce livre !
Un peu avant, le Guide culinaire, lui, évoque des « oeufs à la neige » que l’on fait en moulant à la cuiller, en forme d’oeuf, de la « meringue ordinaire », que l’on fait tomber dans dans un sautoir contenant du lait bouillant sucré et vanillé. Avec le lait, passé à la mousseline et additionné de 10 jaunes par litre, on prépare une crème anglaise ; on dresse les œufs sur un compotier et on les couvre avec la crème anglaise. On notera que les anciens auteurs parlaient de « meringue » pour désigner des blancs d’oeufs battus en neige sucrés. D’ailleurs, le Guide culnaire discute aussi des oeufs à la neige moulés : on les prépare de la même façon, mais on ajoute dans la crème cinq ou six feuilles de gélatine trempées à l'eau froide.
Ce même Guide culinaire parle plus loin d’« île flottante » : il s’agit de partir d’un biscuit de Savoie rassis, de le détailler en tranches minces, d’imbiber ces tranches avec kirsch et marasquin, de les masquer de confiture d'abricot, de parsemer celle-ci de raisins de Corinthe et d'amandes hachées ; on remet alors les tranches l'une sur l'autre, de manière à reformer le biscuit, on masque d'une couche de crème Chantilly sucrée et vanillée, et l’on parsème la surface de la crème avec des pistaches effilées et des grains de Corinthe; on dresse sur un compotier et entourer de crème anglaise vanillée, ou de sirop de framboises.
Rien à voir avec un œuf à la neige, donc ! Aurions-nous d’autres îles flottantes chez des auteurs précédents ? Rien chez Emile Darenne et Emile Duval, qui discutent toutefois d’oeufs à la neige, à cela près qu’ils ajoutent un peu de fécule dans leur crème anglaise (qui devient donc plutôt une crème pâtissière).
Rien, non plus, chez Joseph Favre, qui remplace le lait par de la crème, qu’il préconise de faire réduire avant de sucrer, de vaniller, et de pocher les œufs. On lie ensuite la crème avec des œufs, et il signale que l’on peut varier le goût, remplacer la vanille par des zestes de citron, d’anis, tandis que l’on peut aussi colorer.
Et notre île flottante ? Toujours rien chez Urbain Dubois non plus, en 1898, mais une ancienneté : le pochage se fait dans l’eau. Et avant ? Pierre de la Varenne, dans son Cuisinier françois, indique que les œufs à la neige ne sont pas ce qui nous a été transmis :
« Faites bouillir du lait avec un peu de farine ; mettez-y ensuite six blancs d’oeufs ; remuez bien, sucrez et lorsque vous serez prêt de servir, remettez sur le feu, et glacez ; ou bien jetez par dessus le reste de vos blancs bien frits ; passez y légèrement un couvert de four, et servez sucré avec quelques eaux de senteur. Vous pouvez, au lieu de blancs, y mettre le jaune de vos œufs à proportion, et les blancs frits par dessus. La crème à la Mazarine se fait de même, hormis que vous n’y mettez point de blancs d’oeufs. »
Rien à voir, donc ! D’ailleurs, il donne une autre recette, avec le même nom :
« Cassez des œufs, séparez les blancs des jaunes, mettez les jaunes dans un plat sur du beurre, et les assaisonnez de sel, et posez-les sur de la cendre chaude ; battez et fouettez bien les blancs, et peu avant que de servir, jetez-les sur les jaunes avec une goutte d’eau rose, et la pelle du feu par dessus, puis sucrés. Autre façon. Vous pouvez mettre les jaunes au milieu de la neige, qui est de vos blancs fouettés, et les faites cuire devant le feu un plat derrière. »
Mais pas d’île flottante non plus !
Et c’est ainsi que la seule « île flottante » que l’on trouve est donc celle du Guide culinaire, qui n’est pas l’oeuf à la neige. On aurait donc intérêt à ne pas tout confondre !
IMBIBER :
(tlfi) Faire pénétrer un liquide dans un corps, une matière.
(P. Lacam, Nouveau Mémorial de la pâtisserie) Verser légèrement du sirop sur un gâteau avec un pinceau.
IMPÉRIALE
(TLFi) Dans le Bordelais, bouteille d'une contenance de 6 litres.
INAO :
L'Institut National de l'Origine et de la Qualité, ou INAO est un établissement public à caractère administratif français placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Administré par des représentants des vignerons et négociants issus de l’ensemble des régions viticoles, il accompagne les producteurs qui s'engagent dans les démarches de qualité et gère plus globalement les signes d'identification de l'origine et de la qualité pour les produits élaborés en France qui sont des signes officiels français (AOP, AOC, IGP).
INCISER :
(ref nec) Action de pratiquer des entailles peu profondes sur les côtés d’un poisson. Autres termes utilisés « ciseler, contiser ».
INCORPORER :
Mélanger un aliment dans un autre.
INCRUSTER :
(ref nec) Imprimer en creux des motifs décoratifs sur la surface d'un gâteau, d'un moulage en pâte d'amandes, etc.
INFUSION :
(H. This) Liquide obtenu après qu'une substance a été placée dans un liquide bouillant. Par exemple, du thé. Se distingue de la macération et de la décoction.
INGRÉDIENT :
(TLFi) Élément d'une préparation ou d'un mélange quelconque.
INGRÉDIER :
(Michel Grossmann ) Mélanger intimement.
Néologisme. Terme usuellement employé par certains pâtissiers pour définir un mélange d’ingrédients. Ne figurant pas dans la langue Française ni dans les lexiques professionnels.
Du latin : Ingrédi : infinitif de {ingredior} : entrer, s’introduire, pénétrer, aller dedans.
INTERSPÉCIFIQUE
(ref nec) Variété obtenue par croisement entre une ou plusieurs espèces différentes (voir hybride ou métis), généralement entre vitis européennes, vitis américaines, vitis asiatiques.. Lorsque l'on est en présence d'une variété issue d'un croisement entre espèces identiques, on utilise le mot intraspécifique.
INTROGRESSION
(ref nec) technique génétique qui consiste en l'infiltration d'allèles ou de gènes d'une espèce vers une autre espèce par hybridation. Une première génération d'hybrides (hybrides F1, les parents sont F0) possède une contribution génétique égale de chacun des deux parents mais les gènes des deux espèces commencent à se séparer différemment dans les générations suivantes.
INULINE :
(economie.gouv.fr) Fructane (polymère de fructose liés en β) naturellement présent dans des plantes telles que oignons, asperges, chicorée, ail, blé ou seigle.
INVERTASE :
(ref nec) Enzyme (notamment présente dans les levures) qui transforme le saccharose en D-glucose et fructose. Sa dénomination internationale est EC 3.2.1.26.
INVOLUTÉ
(TLFi) Qui est roulé de dehors en dedans. Feuilles involutées ou involutives. Les feuilles proprement dites, lorsque leur limbe a acquis une certaine grandeur dans le bourgeon, y sont en général diversement pliées ou roulées sur elles-mêmes, de manière à s'adapter à sa forme arrondie et à occuper le moins de place possible.
Se dit lorsqu'une feuille de vigne se referme vers le haut rappelant quelquefois une assiette. L'aspect contraire se dit révoluté (voir ce mot).
IPNYTES :
(ref nec) Pain cuit dans le four (Grèce)
IRISH COFFEE :
(IBA) Cocktail à trois couches : café sucré, whisky, crème éventuellement fouettée. La boisson aurait été popularisée après 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale par Joseph Sheridan, patron du Pub O’Regan.
IRISH STEW :
(ref nec) L’irish stew est un ragoût de mouton aux pommes de terre. La pomme de terre, introduite en Irlande au XVIe siècle, y est devenue la base de l’alimentation ; elle s’associe dans ce mets au goût corsé du mouton (et non à de l’agneau). Les morceaux de collier sont disposés par couches alternées avec des rondelles de pomme de terre et des oignons émincés, mouillés d’eau et mis à mijoter à petit feu. L’accompagnement traditionnel prévoit du chou rouge mariné aux épices. De manière moins traditionnelle, l’irish stew peut être préparé avec de l’agneau accompagné de navets, de carottes, de panais ou d’orges, mouillée à la bière stout.
ISOGLUCOSE :
(economie.gouv.fr) Mélange de D-glucose et de D-fructose obtenu par hydrolyse de l’amidon puis
isomérisation (par une enzyme microbienne) du D-glucose en D-fructose. Les mélanges ont
une teneur en D-fructose de 42 à 55% de la matière sèche
ISOHYDRIQUE
(ref nec) Se dit d'un cépage présentant une forte capacité à fermer les stomates lors d'un stress hydrique, exemple le merlot noir. Le contraire est un cépage anisohydrique, exemple la syrah.
ISOMALT :
(economie.gouv.fr) mélange de disaccharides hydrogénés obtenu par réduction catalytique de
l’isomaltulose (voir ce mot). Il est constitué d’un mélange de glucose-sorbitol α (1-6) et de glucose
mannitol α (1-1).
ISOMALTULOSE :
(economie.gouv.fr) disaccharide produit par isomérisation enzymatique de saccharose.
ISOTHIOCYANATES :
(ref nec) Composés organosulfurés auxquels on doit l'essentiel du piquant du raifort, du wasabi, de la moutarde, du cresson... Pour l'isothiocyanate d'allyle, sa formule semi-développée est CH2CHCH2NCS.
ISSUES :
(TLFi) Boucherie : Parties dites du cinquième quartier, comprenant les abats et les parties non consommables : cornes, cuirs, suif, viscères.
(TLFi) Meunerie : Produits, autres que la farine, obtenus au cours de la mouture des céréales (son, remoulage, recoupe, etc.).
ITALIENNE (A L')
(Massialot) persil, ciboule, champignons, truffes, foies, lard, beurre, herbes, épices, hachés, farcir les poulets, rôti broche, avec persil, ciboule, estragon blanchis et broyés, jaunes d'oeufs, vin, huile, anchois, citron, coulis.
IVOIRER :
(ref nec) Donner à du riz une légère coloration du riz en le faisant revenir dans de la matière grasse.
Donner une légère coloration à une sauce blanche où l’on a ajouté de la glace de viande.